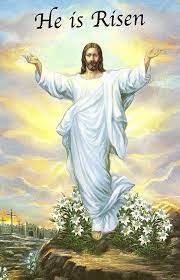par Vincent Ojwang | Mar 26, 2025 | Nouvelles de la base
Le dernier mardi de chaque mois, les Sœurs Missionnaires de Saint Antoine Marie Claret organisent une lectio divina itinérante avec nos frères et sœurs sans-abri. La rencontre a lieu à partir de 20 heures « dans la maison de Paul ». Après la fermeture des magasins près de la place Saint-Pierre, alors que quelques touristes passent encore, Paul pose sa valise par terre et la recouvre d’un drap. C’est l’autel autour duquel il réunit un petit groupe d’amis – des personnes démunies, des volontaires d’une paroisse voisine, quelques prêtres, des religieux, des laïcs – pour écouter et méditer la Parole de Dieu.
Il s’agit d’une initiative de la communauté où vit Sœur Elaine Lombardi MC, qui, après plusieurs années d’accompagnement de cette réalité, estime que les « sans-abri » n’ont pas seulement besoin de nourriture et de couvertures, mais de quelque chose de plus. Comme le souligne le pape François dans Evangelii Gaudium, dans l’un des numéros les plus stimulants de cette exhortation apostolique : « Je veux exprimer avec tristesse que la pire discrimination subie par les pauvres est le manque d’assistance spirituelle. La grande majorité des pauvres ont une ouverture particulière à la foi ; ils ont besoin de Dieu et nous ne pouvons pas ne pas leur offrir son amitié, sa bénédiction, sa Parole, la célébration des sacrements et la proposition d’un chemin de croissance et de maturation dans la foi. L’option préférentielle pour les pauvres doit se traduire avant tout par une attention religieuse privilégiée et prioritaire » (EG 200)
Cette « lectio divina dans la rue » est un petit signe qui cherche à répondre au souci du pape François d’offrir un accompagnement spirituel aux pauvres. Chaque rencontre est une expérience unique de communion et d’espoir. Au milieu de l’agitation de la Ville éternelle qui s’éteint peu à peu, la petite assemblée se rassemble autour de la Parole, y cherchant consolation et force. Des réflexions émergent de la réalité concrète des participants. Certains partagent leurs expériences de lutte quotidienne, d’autres expriment leur gratitude pour avoir trouvé dans cet espace un moment de paix. La Parole de Dieu illumine les ombres de la rue et rappelle à chacun sa dignité et sa valeur. Il n’y a pas de hâte, pas de distance : dans cette « maison de Paul », tous sont frères et sœurs.
Outre la prière et la réflexion, la réunion devient l’occasion d’apporter une aide concrète. Des bénévoles distribuent du café ou du thé chaud, des sandwichs et quelques couvertures pour la nuit froide. Mais, comme le souligne Sœur Elaine, le plus important est le temps partagé, l’écoute attentive et la reconnaissance de chaque personne dans son histoire et sa souffrance. Montrer la chaleur d’une communauté qui accueille et accompagne. « L’Évangile nous appelle à regarder les pauvres avec les yeux de Jésus », dit un jeune volontaire. « Parfois, nous pensons qu’aider, c’est donner des choses matérielles, mais ils nous enseignent que la chose la plus précieuse est de se sentir aimé, écouté et compris.
Au fur et à mesure que la soirée avance et que la lectio divina se termine, des demandes spontanées sont formulées : pour la santé, pour le travail, pour une chance d’aller de l’avant. Enfin, un Notre Père et une bénédiction marquent la fin de la réunion, mais pas la fin de la fraternité. Beaucoup restent pour parler, partager des expériences et renforcer les liens que cette initiative nous a permis de tisser. Pour ceux qui y participent, cette lectio divina itinérante est un rappel que la foi se vit dans la rencontre avec les autres, en particulier avec ceux que le monde a tendance à oublier. C’est un signe du Royaume de Dieu qui est présent dans la rue, dans la nuit, dans le cœur de ceux qui, même dans l’adversité, continuent à faire confiance et à espérer.
Dans le contexte de cette année jubilaire consacrée au thème de l’espérance, il convient de rappeler la signification biblique du Jubilé en tant qu' »année de libération », telle qu’elle est décrite par le prophète Isaïe (61,1-2). Le passage d’Isaïe 61,1-2 occupe une place centrale dans le récit que fait Luc de la visite de Jésus à Nazareth (Lc 4,14-30). Dans cette scène inaugurale, qui a une valeur programmatique et solennelle. Jésus proclame un message profondément transformateur au cours d’une liturgie dans la synagogue. Après avoir lu : « L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a consacré par l’onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ; il m’a envoyé proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés et proclamer une année de grâce pour le Seigneur » (Lc 4,18-19), Jésus affirme : « Aujourd’hui s’accomplit cette parole que vous venez d’entendre » (Lc 4,21).
L' »année de grâce » est un thème clé de ce texte et renvoie au Jubilé de l’Ancien Testament, un temps de libération, de restitution et d’équité qui marquait la remise des dettes et la liberté des esclaves. Cependant, Jésus redéfinit ce concept comme un temps de grâce universelle, excluant toute idée de vengeance divine. La grâce de Dieu, telle que Jésus la présente, ne discrimine ni n’exclut ; c’est un don offert à tous, en particulier aux plus pauvres et aux plus marginalisés
Luc souligne que le message de Jésus ne peut être réduit à une interprétation purement spirituelle. Les « pauvres » dont il parle sont ceux qui sont exclus des biens de ce monde, et l’annonce de la Bonne Nouvelle implique une transformation concrète de leur vie. Pendant des siècles, une spiritualisation excessive de la pauvreté a éloigné l’Église de sa mission originelle : l’annonce du Royaume de Dieu et de sa justice.
Saint Antoine Marie Claret a lu les textes d’Isaïe et de Luc dans une tonalité vocationnelle :
Le Seigneur m’a fait savoir que je ne devais pas seulement prêcher aux pécheurs, mais aussi aux simples dans les champs et les villages, que je devais catéchiser, prêcher, etc. etc. et c’est pour cela qu’il m’a dit ces mots : Les nécessiteux et les pauvres cherchent de l’eau et il n’y en a pas ; leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai, moi, le Dieu d’Israël, je ne les abandonnerai pas (17). (17) Je ferai jaillir des fleuves sur les sommets des collines et des sources au milieu des champs, et ce qui est aujourd’hui un désert stérile sera une source d’eau saine et abondante.
Et d’une manière toute particulière, Dieu Notre Seigneur m’a fait comprendre ces paroles : Spiritus Dominis super me et evangelizare pauperibus misit me Dominus et sanare contritos corde (citant de mémoire Lc 4,18 / Cf. Is 61,1) (Aut 118).
Claret a compris que sa mission n’était pas seulement de sauver les pécheurs de l’enfer, mais concrètement de rejoindre les plus pauvres et les plus incultes. Comme nous le savons, il a également compris la vocation de ses missionnaires à la lumière de ces paroles. Inspiré par Isaïe et Luc, il a compris que sa mission et celle de ses missionnaires était d’aller vers les plus démunis. Aujourd’hui, nous dirions qu’il faut aller aux périphéries géographiques et existentielles.
En ce sens, la Lectio avec les pauvres sur la place Saint-Pierre devient le témoignage vivant d’une Église qui sort, qui s’engage concrètement auprès de ceux qui en ont le plus besoin. Dans la « maison de Paul », la Parole s’incarne dans la réalité des sans-abri, la foi se vit dans la communion, la reconnaissance de la dignité humaine et la solidarité authentique. Cette expérience nous rappelle que le message de l’Évangile n’est pas une simple proclamation, mais une invitation à laisser la Bonne Nouvelle être annoncée dans l’humilité, à travers les pauvres eux-mêmes, qui, par leur témoignage, révèlent le visage transformateur et humanisant de l’Évangile. Ainsi, au milieu du froid et de la nuit qui s’abattent sur la Ville éternelle, l’engagement d’accompagner, de libérer et de donner de l’espoir est réaffirmé, rendant tangible l’esprit du Jubilé et la promesse d’une année de grâce pour tous. Les pauvres nous évangélisent !
Edgardo Guzmán CMF
par Vincent Ojwang | Fév 23, 2025 | América, Nouvelles de la base
Anselmus Baru, cmf
À la fin de l’année 2024, le Père Antonio Llamas m’a demandé d’écrire sur la réalité sociale du Venezuela, à partir de mon expérience missionnaire. C’est donc avec humilité que je me lance dans cet exercice. Je n’écris pas avec une prétention à l’exhaustivité ou à une analyse profonde de la situation. Conscient de mes limites d’interprétation, je me contente de partager ce que nous avons vécu dans ce beau pays. À travers ces lignes, j’ai également cherché à mettre en lumière quelques initiatives émergentes, nées du contexte lui-même, et qui tentent d’apporter une réponse à la réalité sociale dans laquelle nous sommes immergés.
Ce texte a été initié après la prestation de serment de Nicolás Maduro comme président du Venezuela, le 10 janvier 2024, à la suite des résultats controversés des élections présidentielles du 28 juillet 2024. Cependant, ces lignes n’ont pas pour objectif d’offrir une analyse politique de cet événement, mais plutôt de partager une expérience vécue au quotidien. Il s’agit de recueillir les moments et actions missionnaires dans le contexte social auquel nous sommes confrontés, tout en intégrant quelques réflexions et résultats de recherche d’experts afin d’enrichir l’analyse de cette réalité sociale complexe que nous vivons au Venezuela.
Une réalité sociale, politique et économique complexe
Depuis plus d’une décennie, le Venezuela est pris au piège d’une crise profonde, qui affecte tous les aspects de son économie. Cette crise trouve son origine dans l’effondrement du modèle économique, largement dépendant des exportations de pétrole et de la centralisation économique de l’État. Parallèlement, le pays a connu une détérioration progressive de sa démocratie au cours des dernières décennies.
Quatre facteurs clés permettent de mieux comprendre cette crise, selon Víctor Mijares, professeur au département de sciences politiques de l’Universidad de los Andes :
La dépendance au pétrole : Le pétrole façonne les relations sociales et l’identité nationale des Vénézuéliens, mais il n’emploie pas plus de 150 personnes directement, ce qui le rend insuffisant pour soutenir l’économie nationale.
L’omniprésence de l’État : La relation entre l’État et la société est marquée par le clientélisme et le paternalisme, renforçant la dépendance des citoyens aux politiques gouvernementales.
La relation civilo-militaire : Le pouvoir repose sur un schéma prétorien, où l’armée joue un rôle central dans le maintien de l’équilibre politique.
Les relations internationales : Une élite restreinte profite des ressources pétrolières, tandis que le Venezuela se retrouve pris dans un jeu d’influences entre la Russie, la Chine et les États-Unis, ce qui crée une situation instable et précaire.
Ce contexte permet de comprendre comment le Venezuela, autrefois l’un des pays les plus riches d’Amérique latine grâce à son économie pétrolière, est aujourd’hui plongé dans une crise économique et politique profonde, le rendant l’un des pays les plus fragiles de la région.
Les indicateurs économiques du Venezuela montrent une détérioration alarmante. Le PIB par habitant a fortement chuté sous la présidence de Nicolás Maduro, passant de 8 692 dollars en 2013 à seulement 3 867 dollars en 2024, soit une perte de 4 825 dollars. L’extrême pauvreté et l’inégalité sont devenues des réalités omniprésentes, reflétant un pays en déclin, pris au piège des multiples dimensions de la crise. Cette situation a été aggravée par les sanctions économiques internationales, notamment l’embargo américain.
Selon Luis Oliveros, doyen de la faculté d’économie et de sciences sociales de l’Université métropolitaine du Venezuela, la production pétrolière du pays ne représente aujourd’hui qu’un tiers de ce qu’elle était il y a quinze ans. Face à cette chute, le gouvernement a mis en place une stratégie fiscale visant à augmenter les impôts sur le secteur privé. Cette politique entraîne des conséquences notables : hausse des coûts pour les entreprises, baisse de la production et affaiblissement du tissu économique national.
La crise vénézuélienne a également provoqué une migration massive vers d’autres pays d’Amérique latine et d’Europe. Selon le HCR, plus de 7,7 millions de Vénézuéliens ont quitté leur pays pour chercher une vie meilleure, dont 6,5 millions accueillis dans les pays d’Amérique latine et des Caraïbes. Cependant, cet exode génère à son tour des problèmes dans les pays d’accueil, tels que la xénophobie, les violations des droits humains, l’exploitation de la main-d’œuvre qualifiée à bas prix, ainsi que des phénomènes sociaux préoccupants comme la prostitution et la maltraitance.
Au Venezuela, cette fuite des cerveaux a provoqué une pénurie de professionnels dans des secteurs clés tels que la santé, l’éducation, la technologie et l’industrie. Un autre enjeu majeur est l’éclatement des familles, conséquence directe de la migration. De nombreux Vénézuéliens envoient de l’argent à leurs proches restés au pays, faisant des transferts de fonds (remesas) un pilier essentiel de l’économie nationale. Environ 35 % des ménages vénézuéliens reçoivent ces aides, avec un montant moyen de 65 dollars par mois. En 2024, ces transferts ont atteint 3 milliards de dollars, soit une augmentation de 120 % par rapport à 2020, où ils s’élevaient à 1,3 milliard.
Sur le plan monétaire, bien que la monnaie officielle du Venezuela reste le bolivar, c’est le dollar américain qui domine les transactions du quotidien, entraînant une dollarisation informelle de l’économie. Le gouvernement tente de réguler cette réalité par l’intermédiaire de la Banque centrale du Venezuela, qui ajuste le taux de change de manière fluctuante. Cette instabilité monétaire a un impact direct sur le pouvoir d’achat des ménages et accentue la précarité économique du pays.
Les fluctuations monétaires au Venezuela exacerbent l’instabilité économique. Selon les statistiques, le dollar BCV n’a augmenté que de 2,67 % au cours des neuf premiers mois de 2024, mais depuis octobre, il a grimpé de 40,66 %. Cette brusque envolée impacte directement les prix des matériaux, des denrées alimentaires, des soins de santé et du coût de la vie en général, qui varient chaque jour selon le taux de change en vigueur. Cette instabilité freine le développement économique et aggrave la crise.
De plus, les marchés ne se basent pas toujours sur le taux officiel de la Banque centrale du Venezuela (BCV). Plusieurs modèles de change coexistent: le marché parallèle, souvent plus élevé que le taux officiel, et le taux moyen, calculé à partir de différentes références.
Cette diversité des taux de change entraîne une volatilité constante des prix, rendant encore plus difficile la prévision des coûts pour les ménages et les entreprises.
Dans ce contexte, les résultats de l’ENCOVI 2023 (Enquête nationale sur les conditions de vie) sont alarmants :
51,9 % de la population vit sous le seuil de pauvreté.
89 % des ménages souffrent d’insécurité alimentaire et ne peuvent couvrir le coût du panier alimentaire de base.
70 % de la population réside dans des zones exposées à des risques élevés de catastrophes naturelles.
Le chômage est également un point de controverse. Le gouvernement vénézuélien estime qu’il s’élève à 7,8 %, tandis que la Banque interaméricaine de développement (BID) le situe plutôt à 40,3 %, un écart significatif qui illustre le fossé entre les chiffres officiels et la réalité du terrain.
L’accès aux services de base est tout aussi préoccupant. Selon l’Observatoire vénézuélien des services publics (OVSP) :
77 % des Vénézuéliens ont un accès limité à l’eau.
Seuls 11 % de la population bénéficient d’un accès quotidien à l’eau potable.
Ces données témoignent de la profonde crise humanitaire que traverse le pays, où l’instabilité économique se conjugue avec des conditions de vie de plus en plus précaires.
Alimentation, santé et éducation
L’alimentation, la santé et l’éducation sont des droits fondamentaux au cœur de la crise actuelle au Venezuela. La détérioration des conditions de vie des Vénézuéliens s’est accélérée ces dernières années, limitant drastiquement l’accès à une alimentation adéquate, en raison de l’inflation galopante.
Lors de sa visite au Venezuela en février 2024, Michael Fakhri, rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à l’alimentation, a souligné :
« Les familles vénézuéliennes rencontrent de grandes difficultés pour subvenir à leurs besoins fondamentaux. Beaucoup sont contraintes de réduire leurs portions alimentaires, de sauter des repas ou d’acheter des produits moins nutritifs. »
Cette insécurité alimentaire a des répercussions directes sur la santé de la population. Selon une étude intitulée « Venezuela : radiographie d’un système de santé en crise », 30 % des hôpitaux publics ne disposent d’aucun matériel de base, tels que draps, blouses chirurgicales, masques ou équipements médicaux essentiels.
Le système de santé public, développé avec l’appui de l’État cubain, peine à fonctionner en raison du manque chronique de ressources. Bien que certaines assurances privées existent, elles restent inaccessibles à la majorité des Vénézuéliens. Selon l’ONG Médicos Unidos por Venezuela, plus de 90 % de la population ne peut pas souscrire une assurance maladie ou financer une hospitalisation privée. Dans les hôpitaux publics, les délais pour une intervention chirurgicale sont très longs et les patients doivent eux-mêmes acheter une partie du matériel médical nécessaire, aggravant leur détresse financière.
L’éducation vénézuélienne est également frappée de plein fouet par la crise. En octobre 2024, le média Deutsche Welle (DW) a relayé une étude de l’Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes de Venezuela, révélant que plus de la moitié des enseignants vivent sous le seuil de pauvreté. Selon la Fédération vénézuélienne des enseignants (CENDAS-FVM), le salaire mensuel moyen d’un enseignant est d’environ 21 dollars au taux de change officiel. Or, le coût du panier alimentaire de base était estimé à 107,8 dollars par personne en août 2024, rendant impossible la satisfaction des besoins essentiels. De plus, les enseignants doivent eux-mêmes acheter du matériel pédagogique et financer leurs déplacements, ce qui pèse encore davantage sur leur budget.
Face à ces conditions précaires, le décrochage scolaire et le manque d’enseignants explosent. Les infrastructures éducatives, souvent inadéquates, entravent le bon déroulement des cours et compromettent l’avenir de milliers d’élèves. Une étude menée par DevTech Systems, en partenariat avec l’Université des Andes, identifie les principales causes de l’absentéisme scolaire sur la période 2020-2021 :
· 78,3 % : manque de nourriture à la maison,
· 56,7 % : absence de services de base,
· 55,5 % : incapacité à acheter du matériel scolaire,
· 44,4 % : problèmes de santé,
· 43,7 % : nécessité d’aider aux tâches domestiques,
· 43,5 % : perte d’intérêt pour les études,
· 39,7 % : perception d’une éducation non essentielle,
· 25,9 % : coût du transport trop élevé.
En outre, 56,9 % des élèves déclarent souffrir de vulnérabilité alimentaire, un facteur qui accentue le cycle de pauvreté et d’exclusion.
Initiatives clarétaines de la ligne de solidarité et de mission-SOMI
La présence clarétaine au Venezuela est intimement liée à la réalité de sa population. La vocation missionnaire consiste à avancer aux côtés des gens, en étant pleinement conscients des défis qu’ils rencontrent au quotidien.
Notre Congrégation reconnaît le défi humain le plus urgent : la durabilité de la vie humaine et de notre maison commune. En suivant les orientations du Chapitre (QC 81-86), la Province Colombie-Venezuela réinterprète ce rêve global pour l’adapter aux réalités de l’Organisme et de ses deux régions de mission. Nous aspirons à une province où les communautés s’engagent activement dans la préservation de la Maison Commune, la construction de l’interculturalité, et la promotion de la justice et de la paix évangélique dans le cadre d’un projet de Solidarité et de Mission.
Dans cette perspective, nous œuvrons pour la dignité et l’égalité des individus, des peuples et des communautés, favorisant leur autodétermination, leur durabilité, et la préservation de notre maison commune. Nos engagements deviennent des repères qui orientent nos actions et renforcent notre solidarité avec les plus démunis et les victimes. Comme nous le savons, il est impossible d’être clarétain sans reconnaître l’existence des pauvres et des victimes, sans dénoncer les structures d’injustice et sans proposer des alternatives pour lutter contre le système qui les perpétue.
Face à la réalité vénézuélienne, nos communautés, guidées par notre vocation missionnaire et les lignes d’action de la Congrégation, ont établi des structures pour l’animation pastorale de Solidarité et Mission (SOMI) et de Justice, Paix et Intégrité de la Création (JPIC) à différents niveaux (local, zonal et régional). Cela nous permet de dynamiser nos actions sociales au sein de notre mission. Au-delà des services sacramentels offerts dans nos centres missionnaires (paroisses, écoles, maisons de formation), notre situation actuelle nous incite à adopter une approche créative qui dépasse le simple culte. Nous devons entrer dans la sphère sociale, car les processus religieux doivent s’harmoniser avec les réalités sociales des gens ; nous ne pouvons pas rester indifférents à leur situation.
De manière structurée, la province, à travers la procuration missionnaire, la Proclade ColVen, les communautés locales et la procuration missionnaire générale, s’associe à certaines organisations de la Congrégation, à nos écoles, à des ONG locales et à Caritas diocésaine. Ensemble, nous répondons de manière créative aux défis de la crise dans différentes régions, en tenant compte des contextes et des besoins spécifiques de chaque localité.
Plusieurs initiatives méritent d’être mises en avant :
- Pot de solidarité : En période de crise aiguë et pendant la pandémie de Covid-19 (2017-2021), des centres missionnaires tels que San Félix, Delta Amacuro, et Mérida ont mis en place l’initiative « Pot de solidarité ». Cette action continue aujourd’hui, consistant à préparer et distribuer des aliments aux personnes les plus démunies dans nos localités.
- Soins médicaux : Nous organisons un dispensaire médical en collaboration avec des ONG, des communautés religieuses et Caritas diocésaine, assurant des soins primaires aux personnes dans le besoin. Ces services sont offerts dans nos paroisses de Delta Amacuro, San Félix, Caracas, et Mérida.
- Jeunes, art, culture et sport : Dans chaque centre missionnaire, nous soutenons le travail et la formation des jeunes. Le mouvement ANCLA (Antonio Claret), en activité depuis 45 ans, reste un moyen prometteur de former les jeunes en tant qu’agents de transformation.
- Formation à l’entrepreneuriat : Dans des zones de mission comme Delta Amacuro, San Félix, Barquisimeto, et Mérida, nous proposons des formations à l’entrepreneuriat et des cours d’artisanat, permettant ainsi aux gens de subvenir aux besoins de leurs familles.
Ces petites initiatives, bien que modestes, sont axées sur le bien-être et représentent un pas significatif vers notre engagement à accompagner les processus sociaux des communautés.
En conclusion
Ces dernières années, certains ont affirmé que la situation au Venezuela s’était améliorée, comme en témoignent les supermarchés avec des étagères remplies de nourriture, la circulation de la monnaie et des prix en dollars. Cependant, une grande partie de la population n’a toujours pas le pouvoir d’achat, ce qui creuse le fossé social entre riches et pauvres.
Pour les clarétains, c’est un défi de continuer à accompagner ces personnes et de marcher avec elles dans leur réalité sociale. Nous devons encourager de nouvelles initiatives pour soutenir les processus sociaux des communautés locales, réaffirmant ainsi notre vocation et notre présence missionnaire comme un signe d’espérance face à cette réalité difficile.